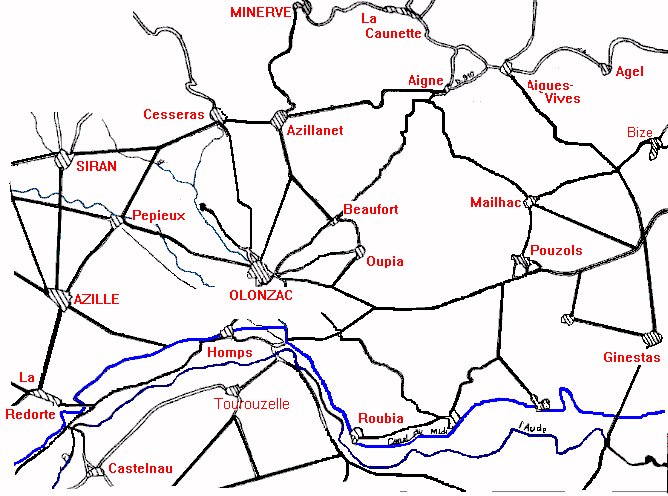
C'est un amphithéâtre de collines, aux terres vivement colorées ou parfois
simples ombres chinoises qui se découpent à l'horizon dominées au nord par le
massif de la Montagne Noire et le pic de Nore (1210 m). En avant-scène, au
sud, une vaste plaine, berceau d'une partie de mes racines enfouies
profondément dans la glèbe tournée et retournée au cours des siècles par mes
ancêtres. Le tout est bordé contre les Corbières au sud, par le fleuve Aude et
son petit-frère domestiqué, le canal du Midi. Son centre économique en est la
ville d'Olonzac dans le département Hérault, mais qui offre la particularité
d'être plus proche de Carcassonne, le chef-lieu de l'Aude et d'être ainsi pour
bien des services administratifs rattaché au département de l'Aude. Exemple:
l'indicatif téléphonique est 04 68 et non pas 04 67.
Ce bourg languedocien
cossu (la visite au cimetière s'impose) mérita en 1926 le prix de la Commune
de France la mieux tenue ! Ilonzac est pourtant un vieux village où abondent
les vestiges romains et carolingiens. Silos, sépultures, amphores, boucles
wisigothiques se rencontrent dans ce sol immergé aux époques préhistoriques.
20 villas gallo-romaines ont été recensées sur son territoire.
Les premiers
habitants connus sont avec certitude du paléolithique puisqu'ils ont laissé de
nombreuses traces dans les grottes naturelles du site de Fauzan. Au deuxième
millénaire, âge du bronze, sont dressés de nombreux dolmens sur le relief qui
domine la plaine minervoise. Toutefois le plus beau, le plus caractéristique
et le plus proche est le Mourrel de Las
Fados ou dolmen des Fées à Pépieux, impressionnante allée-couverte de 25 m
de long.
Olonzac né d'un castrum édifié par les romains de Domitius est
l'endroit idéal au carrefour des routes Narbonne-Minerve et
Béziers-Carcassonne. La pax romana s'installe.
A partir du III° siècle, en
douceur, le paganisme cède la place au christianisme. Puis à partir de 410
arrivent les Wisigoths, ariens, dont une partie se fond dans la population
gallo-romaine. Bien que battus par Clovis en 507, les Wisigoths germanisent la
Narbonnaise jusqu'à ce qu'ils soient évincés par les Arabes en 719. Ces
derniers sont chassés par les populations indigènes qui se rattachent aux
Francs du royaume d'Aquitaine sous la suzeraineté du vicomte de Narbonne et du
comte de Toulouse. La région prend le nom de Pagus Minerbensis qui recouvre
les cantons de Peyriac, aujourd'hui dans l'Aude, et d'Olonzac dans l'Hérault.
Son destin sera alors lié pour le meilleur et pour le pire au comté de
Toulouse jusqu'à la Croisade contre les Cathares au XIII° siècle.
Les Croisades
Après les fondations de deux
abbayes sur son territoire, celle de Caunes à l'ouest et celle de Foncaude à
l'est, les Croisades outre qu'elles entraîneront des fils de famille sur les
routes de l'Orient se matérialiseront par la fondation d'une importante
Commanderie de l'Ordre de Malte sur Homps avec un vaste domaine qui se
maintiendra jusqu'à la Révolution (pour qui sait chercher, plusieurs bornes en
pierre aux armes de Malte ceinturent ce domaine à l'est d'Olonzac). Au XII°
siècle, favorisées par la décadence du clergé régulier et séculier, l'hérésie
cathare puis l'hérésie vaudoise
s'installent. L'armée des Croisés menés par Simon de Montfort déferle sur le
Midi de la France au début du XIII°. Massacres se succédèrent, sac de Béziers
en 1209, prise de Carcassonne puis siège de la fière Minerve, en 1210, qui
sera brûlée avec la plupart de ses habitants.